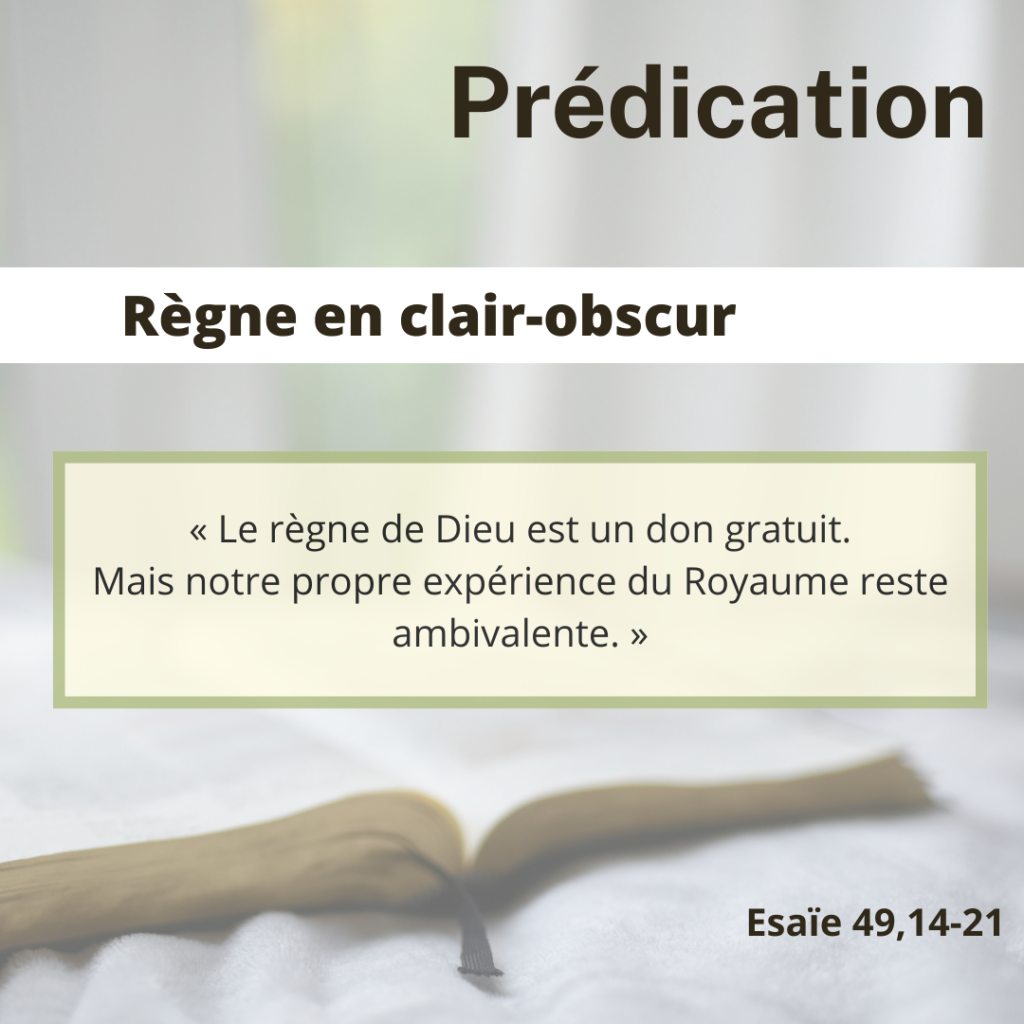Table des matières
Lectures
Esaïe 49,14-21
Jérusalem disait : « Le Seigneur m’a abandonnée, mon maître m’a oubliée. » Mais le Seigneur répond : Une femme oublie-t-elle le nourrisson qu’elle allaite ? Cesse-t-elle d’aimer l’enfant qu’elle a porté ? À supposer même qu’elle l’oublie, moi, je ne t’oublie pas : j’ai ton nom gravé sur les paumes de mes mains, et l’image de tes murailles ne quitte pas mes yeux. Ceux qui vont te rebâtir se dépêchent d’arriver, tandis que partent loin de toi ceux qui t’ont démolie, ceux qui t’ont dévastée. Regarde autour de toi et constate : tes enfants se rassemblent tous et arrivent vers toi. J’en fais le serment aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur, ils seront pour toi comme un bijou dont on se pare, comme une ceinture de fiançailles qu’on se met à la taille. Tu es au milieu des ruines, de quartiers dévastés, ton pays est détruit. Mais il sera bientôt trop étroit pour ses habitants, tandis que partiront très loin ceux qui t’avaient fait disparaître. Tu te croyais privée de fils, mais à nouveau tu les entendras dire : « Je n’ai pas de place, pousse-toi donc un peu, pour que je m’installe ici. » Tu te demanderas alors : « Qui m’a donné tous ces enfants ? J’étais privée des miens et sans espoir d’en avoir d’autres, j’étais exilée et mise à l’écart. Mais ceux-là, qui les a élevés ? J’étais restée seule, et ceux-là, où étaient-ils ? ».
Evangile selon Marc 4,26-29
Jésus disait encore : « Voici à quoi ressemble le règne de Dieu : quelqu’un jette de la semence dans son champ. Nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, les graines germent et poussent sans qu’il sache comment. La terre fait pousser d’elle-même d’abord la tige des plantes, puis l’épi, et enfin plein de blé dans l’épi. Dès que le blé est mûr, on se met au travail avec la faucille, car le moment de la moisson est arrivé. »
Prédication
Cette prédication a été prononcé la première fois le dimanche 24 juin au temple de Gland
Ne pas cacher ce qui est douloureux
Comment ne pas entendre ces textes de l’Ancien Testament avec une note de douleur, un sentiment d’injustice, d’incompréhension, voir de révolte ? Récemment à la fin d’un culte, nous nous sommes retrouvés à avoir un échange vif sur les textes qui avaient été lus. En fait surtout sur un texte qui se trouve dans le Deutéronome.
Ce récit rappelait l’histoire d’Israël, du fait que Dieu a choisi ce peuple, qu’il l’a libéré d’Égypte, qu’il s’est attaché à lui, qu’il lui a donné ses commandements – pour finalement lui promettre un pays dans lequel il trouvera le bonheur (Dt 4,40). Une histoire qui traverse toute la Bible, également le Nouveau Testament.
C’est une histoire d’espérance : celle d’un petit peuple, insignifiant, compressé sur une bande de terre au croisement des grandes puissances antiques : Égypte, Babylone, Perse, Grèce, Rome. Une fois chez l’un, une fois chez l’autre – une fois à l’un, une fois à l’autre. Envoyé en exil, déporté, etc.
Dans cette situation s’est développée une confiance têtue en Dieu – un Dieu qui n’est pas seulement le dieu tutélaire de ce peuple, un dieu parmi d’autres dieux, mais le Dieu avec un « D » majuscule : celui qui accompagne le cours de toute chose, les forces de la nature, les événements politiques, la vie menée par chacune et chacun. Dieu, l’ultime, s’est lié à ce peuple insignifiant et l’a choisi pour être sa lumière sur terre.
Le texte d’Esaïe que nous venons d’entendre participe de cette promesse et de cette espérance. Le royaume de Judée a été détruit par l’empire babylonien. Le peuple a été déporté en différents endroits de l’empire : la ville royale, Jérusalem, est vidée, le pays est dévasté. Mais Dieu annonce que la ville sera à nouveau pleine : non seulement le peuple, mais également les autres nations viendront la remplir et se mettront à son service.
Ce qui pose problème
C’est une espérance immense. Ceux qui n’étaient rien retrouveront une place – et même plus : ils seront élevés plus haut que la place qui était la leur sur l’échiquier des grands de ce monde. Le peuple insignifiant devient la lumière des grands empires. Cela résonne avec ces textes du Nouveau Testament : les « derniers seront les premiers » (Mt 20,16) ou encore « Dieu a choisi ce qui est faiblesse aux yeux de ce monde pour couvrir de honte les forts » (1 Co 1,27). Un renversement des hiérarchies, une promesse de joie pour celles et ceux que la vie malmène, qui souffrent d’injustice, qui se font écraser par les plus forts.
Mais cette promesse est évidemment profondément ambivalente. Avec la restauration de la ville vient aussi une forme de revanche qui frise le sadisme. On peut lire à la suite de notre passage : « Voici ce que déclare le Seigneur, ‘Eh bien oui, je reprendrai à l’homme de guerre celui qu’il avait fait prisonnier, j’arracherai à la brute le butin dont il s’est emparé ! Jérusalem, j’attaquerai moi-même ceux qui t’attaquent et je délivrerai tes enfants. Je forcerai tes oppresseurs à manger leur propre chair, à s’enivrer de leur sang comme on s’enivre de vin nouveau. Alors tout être vivant le saura : moi le Seigneur, je suis ton sauveur, moi le Dieu fort de Jacob, je te libère » (Es 49,25-26). L’oppression est violente, la libération l’est aussi. L’œuvre de guerre des humains est terrible, le contre-coup divin l’est plus encore. Israël petit peuple de rien du tout malmené par ses voisins. Dieu victorieux, qui noie les agresseurs dans leur propre sang. La violence de la vengeance couvre la lumière de la promesse.
Mais c’est peut-être encore autre chose que la violence brute qui nous inquiète : un peuple si conscient de son élection, si sûr du fait que Dieu est de son côté : du pain béni pour les fanatismes et les radicalismes en tout genre… ainsi que pour les politiques étatiques violentes.
Mais plus encore que l’élection, c’est la dimension sociale et politique de la promesse de Dieu à l’égard d’Israël qui inquiète. Oui : l’idée d’un règne de Dieu est fondamentalement sociale et politique. Les mots « royaume » ou « règne » dénote quelque chose qui est de l’ordre du pouvoir, du territoire, mais aussi de la possession. Ces mots indiquent un ordre, des lois, un système d’autorité, une manière de vivre et un lieu pour vivre. La fierté liée à une identité collective.
Dans la promesse de Dieu, le Royaume n’est pas uniquement une réalité intérieure, personnelle, invisible. Ce n’est pas uniquement moi et mon âme devant Dieu. C’est moi, avec autrui, dans ce monde, avec ces relations complexes, notamment des relations de pouvoir.
Et ce serait tellement plus simple si ce n’était pas ça. Ce serait tellement plus simple si la promesse de Dieu ne touchait pas au vivre ensemble – d’ailleurs, notons bien, le vivre-ensemble de tous et de toutes, pas seulement le vivre ensemble du peuple élu. Les nations sont aussi impliquées par la dynamique du royaume de Dieu.
Si l’Église n’est pas le royaume, le fait qu’elle est issue de la même promesse dont bénéficie Israël implique que le problème demeure, pour elle aussi : on ne se débarrasse pas de cette promesse embêtante, qui porte aussi sur notre manière de vivre ensemble, dans le monde, avec Dieu, dans sa création. Une promesse inquiétante, car elle répond à la violence inouïe que les humains s’infligent entre eux, que nous nous infligeons entre nous.
Le royaume de Dieu qui pousse
Est-ce que cela veut dire que la promesse de Dieu nous condamne à une violence insensée, telle celle que nous rapportent jour après jour les médias ? Que l’on pense à Israël Palestine, à l’Ukraine, ou ailleurs ? Est-ce que c’est ça en définitive ? La lutte à mort pour un territoire revendiqué – revendiqué parce qu’il est promis ?
Jésus ne décrit pas la forme sociale et politique du Royaume. Et pourtant il parle constamment du règne de Dieu. D’un règne bien réel, qui advient très concrètement, dans ce monde et avec ce monde. Il le raconte par des images et des paraboles tirées de la vie quotidienne – des petites histoires dont le sens se descelle chaque fois à neuf.
Le royaume est comme ce qui se donne à voir, à entendre, à comprendre dans l’histoire de la semence qui pousse toute seule.
L’établissement et la croissance du règne de Dieu est un don, qui suit sa propre dynamique. L’être humain n’intervient pas sur sa croissance. Il ne fait que semer. Il y a là un écho avec le texte d’Esaïe : Jérusalem, une mère privée de ses enfants, se retrouve, comme par surprise, avec tellement d’enfants que ceux-ci ne savent plus où se mettre. On manque de place. Et Jérusalem se dit : « Qui m’a enfanté ces enfants ? ».
La croissance du royaume n’est pas le fruit de notre action (économique, sociale, politique, militaire), mais d’un agir mystérieux qui appartient à Dieu seul, sur lequel nous n’avons pas de contrôle – et sur lequel nous n’avons pas besoin d’avoir le contrôle.
Ceci ne nous donne pas un programme politique et social. Et en même temps, les images du règne parlent d’une réalité sociale, collective, politique. L’image de la semence qui pousse toute seule suggère un lâcher-prise sur le cours des choses. Un lâcher-prise qui en même temps laisse la place à une créativité collective inouïe. Si nous n’avons pas à créer et assurer l’ordre du règne de Dieu, c’est que nous pouvons nous consacrer librement et de manière créative aux relations que nous avons les uns avec les autres, avec l’ensemble des vivants et le monde qui nous entoure, avec nous-mêmes, avec Dieu. Nous n’avons pas la pression de maintenir l’ordre général : nous sommes libres d’aimer et de goûter les fruits de la moisson.
Je ne sais toujours pas…
Et pourtant l’ombre de la violence persiste. Tout notre agir social, nos revendications, nos espoirs restent marqués d’une violence que le texte d’Esaïe illustre. Notre expérience du Royaume et les rêves que nous en avons restent ambivalents, inquiétants. Et croire que ce ne serait pas comme ça, ce ne serait pas prendre au sérieux les promesses de Dieu à l’égard de son peuple. Ce ne serait pas non plus prendre au sérieux le Dieu qui en Jésus-Christ, dans son règne, s’est entièrement exposé à la violence qui lui est opposée.
Et nous, pour notre part, comme croyants, comme Église du Christ, nous n’avons rien d’autre à lui opposer que l’histoire d’une graine qui pousse tout seuls, sans que rien ni personne n’intervienne. Une histoire qui peut mettre nos vies en lumière – qui met en lumière une vie dans laquelle Dieu est à l’œuvre, une vie où il fait grandir son Royaume, malgré tout ce qui s’y oppose. Parce que Dieu reste fidèle à sa promesse et qu’il ne la retirera pas.
Amen
Sur mon site vous trouverez d’autres messages dans la rubrique Prédications, messages et exégèses
Pour une prédication alternative sur ce même texte, voir le texte de la pasteure Diane Friedli Gravé dans la paume de sa main.

Cette création est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Paternité 4.0 International.