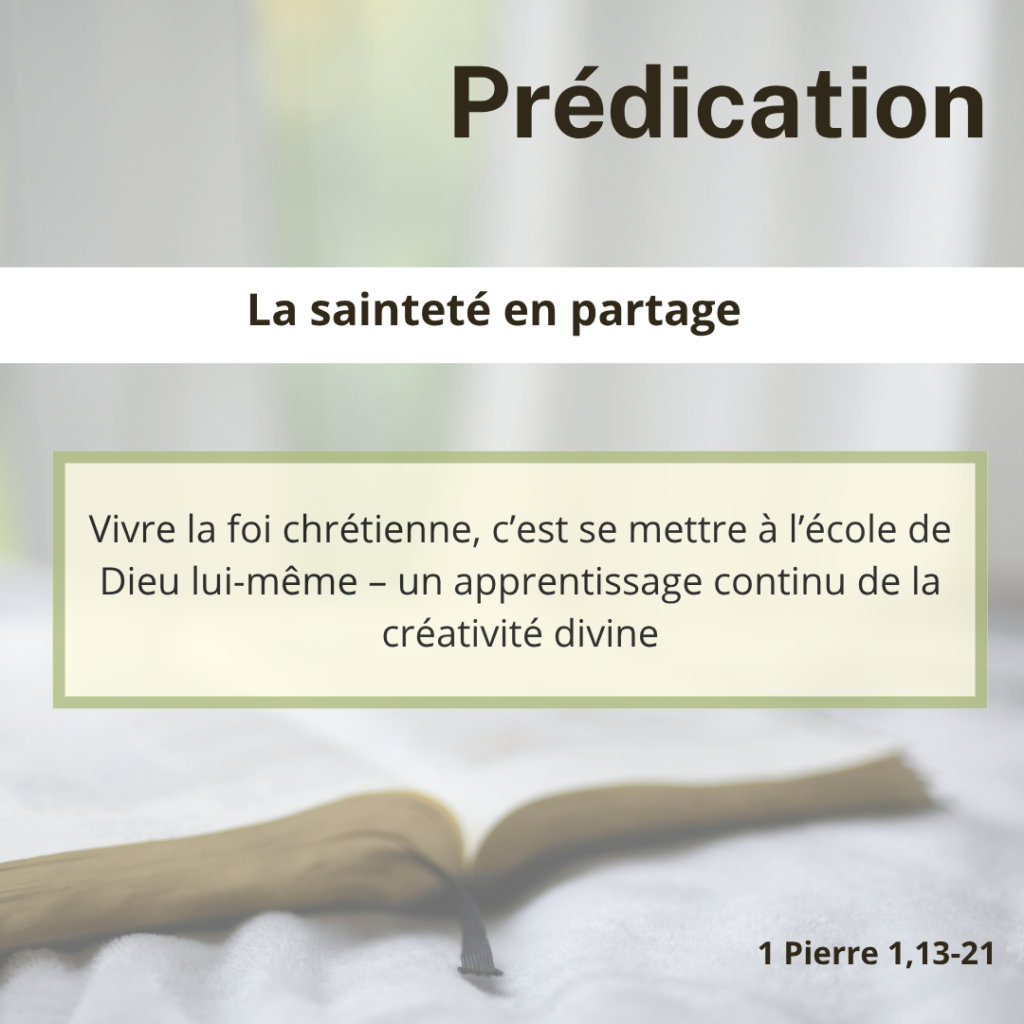Table des matières
Lectures | Nouvelle Français Courant
Esaïe 29,22-24
Voici donc ce que le Seigneur déclare au peuple de Jacob, lui qui a sauvé Abraham : « Désormais le peuple de Jacob ne sera plus humilié, il n’aura plus à pâlir. Lorsqu’eux-mêmes ou leurs enfants verront en effet ce que je ferai parmi eux, ils reconnaîtront que je suis vraiment Dieu, moi, le Dieu saint de Jacob, ils redouteront de me déplaire, à moi, le Dieu d’Israël. Eux qui avaient perdu tout bon sens, ils commenceront à me comprendre ; eux qui protestaient toujours, ils se laisseront instruire. »
1 Pierre 1,13-21
C’est pourquoi tenez-vous prêts à agir, gardez votre intelligence en éveil. Mettez votre espérance tout entière dans le don qui vous sera accordé quand Jésus Christ se révélera. Obéissez à Dieu et ne vous conformez pas aux mauvais désirs que vous aviez autrefois, quand vous étiez encore ignorants. Mais soyez saints dans toute votre conduite, tout comme Dieu qui vous a appelés est saint. En effet, l’Écriture déclare : « Vous serez saints, car je suis saint. »
Dans vos prières, vous donnez le nom de Père à Dieu qui juge de manière équitable, selon ce que chaque personne a fait ; c’est pourquoi, durant le temps qu’il vous reste à séjourner sur la terre, que votre conduite témoigne du respect que vous avez pour lui. Vous savez, en effet, à quel prix vous avez été délivrés de la manière de vivre que vos ancêtres vous avaient transmise et qui ne menait à rien. Ce ne fut pas au moyen de choses périssables, comme l’argent ou l’or ; non, vous avez été délivrés par le sang précieux du Christ, comme celui d’un agneau sans défaut et sans tache. Dieu l’avait désigné pour cela, avant même la création du monde, et c’est pour vous qu’il l’a manifesté dans ces temps qui sont les derniers. Par lui, vous croyez en Dieu qui l’a ressuscité d’entre les morts et qui lui a donné la gloire ; ainsi vous pouvez placer votre foi et votre espérance en Dieu.
Evangile selon Marc 1,21-28
Jésus et ses disciples entrent dans Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, Jésus se rendit à la synagogue et se mit à enseigner. Ceux qui l’entendaient étaient impressionnés par son enseignement ; en effet, il les enseignait avec autorité, à la différence des spécialistes des Écritures. Or, dans leur synagogue, il y avait un homme tourmenté par un esprit impur. Il se mit à crier : « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous détruire ? Je sais bien qui tu es : celui qui est saint, envoyé par Dieu ! » Jésus parla sévèrement à l’esprit impur en lui disant : « Tais-toi et sors de cet homme ! » L’esprit impur secoua rudement l’homme et sortit de lui en poussant un grand cri. Et tous furent étonnés au point de se demander les uns aux autres : « Qu’est-ce que cela ? Un enseignement nouveau donné avec autorité ! Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent ! » Et aussitôt, la renommée de Jésus se répandit partout dans toute la région de la Galilée.
Prédication
Cette prédication a été prononcé pour la première fois au temple réformé de Vaux-sur-Morges le 29 juin 2025.
Une série sur 1 Pierre
la semaine passée, j’ai insisté sur la thématique de la joie et sur la promesse de vie qui permet de ressourcer constamment à neuf cette joie. Et j’ai indiqué à la fin de la prédication que la vie, la mort et la résurrection de Jésus sont les signes que Dieu a placés dans notre histoire, dans notre monde, pour montrer comment il compte tenir cette promesse, la réaliser – pour nous aussi. Cette référence à la vie, à la mort et à la résurrection de Jésus est revenue de manière forte à la fin du texte de la première lettre de Pierre : c’est réellement elle qui fait office de point de référence pour tout ce que nous avons à comprendre de notre vie en présence du Dieu vivant.
Elle sert également de point de référence pour ce que j’aimerais aborder aujourd’hui avec vous : la thématique de la sainteté. C’est important de le rappeler, parce qu’avec la thématique de la sainteté on s’engage en fait sur un chemin dangereux, plein d’embuches et de contresens possibles : un chemin qui plutôt que de nous libérer, présente le risque de nous enfermer à nouveau – la méditation de la mort et de la résurrection de Jésus sont là pour contrer ces formes d’enfermement. Je vais y revenir.
L’appel à l’exigence
Mais donc, la sainteté : je vais re-citer l’extrait que je veux mettre au centre de cette prédication. « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez auparavant, alors que vous étiez ignorants ; mais, de même que celui qui vous a appelés est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite, puisqu’il est écrit : vous serez saints, car, moi, je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui, impartialement, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour à l’étranger. » (1 P 1,14-16)
Un texte dense, plein d’allusions, que je veux essayer de résumer de la manière suivante : si vous vivez de la foi née de la mort et de la résurrection de Jésus, alors vous êtes appelés à vivre d’une certaine manière. Car, la manière dont vous vivez n’est pas égale pour ce Dieu en qui vous portez votre foi : vous êtes appelés à être saints, comme lui est saint.
Être chrétien, c’est donc suivre un appel à être saint. C’est se mettre à l’école d’une certaine exigence.
Impasses
Avant de dire de manière positive ce qu’il en est de cette sainteté – comment on pourrait la comprendre – je veux indiquer quelques impasses : dans le christianisme on a en effet fait tout un tas de choses de cette exigence de sainteté qui l’ont détourné, qui l’ont mise au service d’une logique de soumission et de tristesse qui n’a rien à voir avec la vie que Dieu nous donne et veut toujours nous donner.
Une première impasse, ce serait de comprendre l’exigence de sainteté comme une exigence de perfection. Être saint, c’est être parfait comme Dieu est parfait. Cette piste mène au burnout, au désespoir. L’exigence de sainteté ne veut pas dire que nous devons œuvrer à être parfait.
Une deuxième impasse serait de comprendre l’exigence de sainteté comme une exigence de pureté – il y a des choses avec lesquelles nous pouvons entrer en contact, d’autres avec lesquelles on ne peut pas entrer en contact sans cesser d’être saints. Je ne vais pas m’étaler là-dessus, mais toute la vie de Jésus s’oppose à une telle conception de la sainteté.
Une troisième impasse serait de réduire l’exigence de sainteté à une question d’obéissance morale : il s’agirait au fond de chercher à faire le bien en toutes choses – alors : ne le voyez pas comme un encouragement à faire le mal ! Mais il y a des situations où la division binaire entre le bien et le mal ne fonctionne tout simplement pas, où elle est mise en échec – et c’est précisément ce genre de situation qui appelle à la sainteté !
Conception positive de la sainteté
Maintenant que j’ai pris le temps de dire ce que n’est pas cette exigence de sainteté, je veux essayer de dire ce qu’est cette exigence de manière positive – et vous avez le droit de ne pas être d’accord !
La sainteté désigne d’abord quelque chose qui appartient à Dieu, ou à la sphère du divin. Dieu est saint. Et ce qui appartient à la sphère d’influence, ou de présence, de Dieu est saint. C’est une première manière de définir la sainteté.
Et ça veut dire une chose importante qu’il faut avoir à l’esprit : quand Dieu attend de nous que nous soyons saints, cela veut dire qu’il attend de nous quelque chose qu’il attend de lui-même. L’exigence de sainteté nous appelle à nous tenir dans la présence de Dieu – non pas à distance de Dieu. Dans ce que nous faisons, nous sommes comme imbibés de lui et par lui. Être saint, ça veut dire être ce que Dieu a le plus en propre – ça ne veut pas forcément dire être divin. Parce que Dieu reste Dieu et nous ne sommes pas Dieu. Mais être saint, cela signifie en tout cas être pleinement en présence de Dieu.
Bon. C’est une conception très formelle de la sainteté. Ça ne nous dit pas encore ce que ça change cette sainteté.
Pour cela c’est intéressant d’aller voir dans quels contextes dans l’Ancien Testament on parle de Dieu comme de celui qui est saint. Ce sont toujours des situations où le peuple élu rappelle l’œuvre libératrice de Dieu – où il chante le fait que le Seigneur a libéré le peuple de l’esclavage, qu’il l’a protégé des armées ennemies, qu’il lui a donné le pays, etc. Vous pourriez aller relire le Cantique de Myriam au chapitre 15 de l’Exode (versets 11 et suivants) – c’est très parlant !
Dans sa sainteté Dieu apparaît comme un Dieu qui libère et qui fait vivre. C’est aussi ainsi qu’apparaît Jésus dans les évangiles et très explicitement dans le récit d’exorcisme de l’évangile selon Marc que nous avons entendu tout à l’heure : Jésus vient libérer les personnes des puissances spirituelles dont elles sont les esclaves. C’est ce qui apparemment permet de le qualifier comme le Saint de Dieu.
Dans sa sainteté, Dieu se révèle comme celui qui lutte contre les forces du mal, du péché, de la mort – la sainteté c’est ce qui refuse ces forces. Cela signifie que notre propre sainteté va elle aussi être marquée de ce mouvement, de cette lutte. Attention : je ne fais que parler d’un mouvement général. Cela ne nous dit encore rien de la manière dont nous-mêmes participons de cette lutte. De la forme concrète que le mouvement doit prendre. Là il faut faire un pas de plus, qui anticipe un peu ce dont il sera vraisemblablement question pour le culte de la semaine prochaine.
En effet, on pourrait être tenté de dire que Dieu nous a donné aussi dans les détails la manière de mettre en œuvre cette lutte – oui, d’une certaine manière il le fait : justement dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus, il nous montre définitivement comment il est le Dieu Saint. Mais par cette manière de faire Dieu, déjoue toutes les rigidifications, en fait toutes les sacralisations d’une manière de vivre ou d’être cette sainteté.
Le texte d’Esaïe au chapitre 29 offre une pointe intéressante à ce titre : l’action libératrice de Dieu invite à l’enseignement. On peut le dire ainsi : en libérant son peuple, Dieu renouvelle aussi la compréhension que le peuple a de Dieu et la compréhension de ce que Dieu attend de son peuple en matière de sainteté.
C’est là aussi ce qui se passe avec Jésus : il renverse les attentes en matière de salut. Il renouvelle l’interprétation de la Loi. C’est en perdant sa vie qu’il l’a gagné. Paul parle ici de la parole de la croix (1 Co 1,18) : une réalité qui renverse nos attentes et nos représentations de ce qu’il faut faire dans la présence de Dieu. Ainsi en est-il de la sainteté de Dieu.
Et c’est pour cela que le passage de la première lettre de Pierre en appelle tout autant à l’intelligence qu’il en appelle à la foi. Être saint est une invitation à s’engager activement dans un chemin de découverte – il ne s’agit pas de suivre aveuglément des règles. Il s’agit de discerner en fonction de la situation présente ce que la sainteté invite à dire et à faire en vue de la lutte contre les puissances du mal, du péché et de la mort.
Pour résumer
Vivre la foi chrétienne, c’est se mettre à l’école de Dieu lui-même – c’est ça la sainteté.
Vivre la foi chrétienne, c’est s’inscrire dans ce mouvement de lutte et de libération à l’encontre des puissances qui déforment la création de Dieu – c’est ça la sainteté.
Vivre la foi chrétienne, c’est, à la lumière de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus, développer une écoute attentive et intelligente des situations dans lesquelles nous nous trouvons, afin de découvrir ce que Dieu invente pour cette situation et ce que cette invention nous invite à dire et à faire – c’est ça la sainteté.
La sainteté, c’est pour nous un apprentissage continu de la puissance créatrice et libératrice du Dieu Éternel, ancré dans la confiance et l’espérance.
Amen.
Sur ce site vous trouverez d’autres messages dans la rubrique Prédications, messages et exégèses